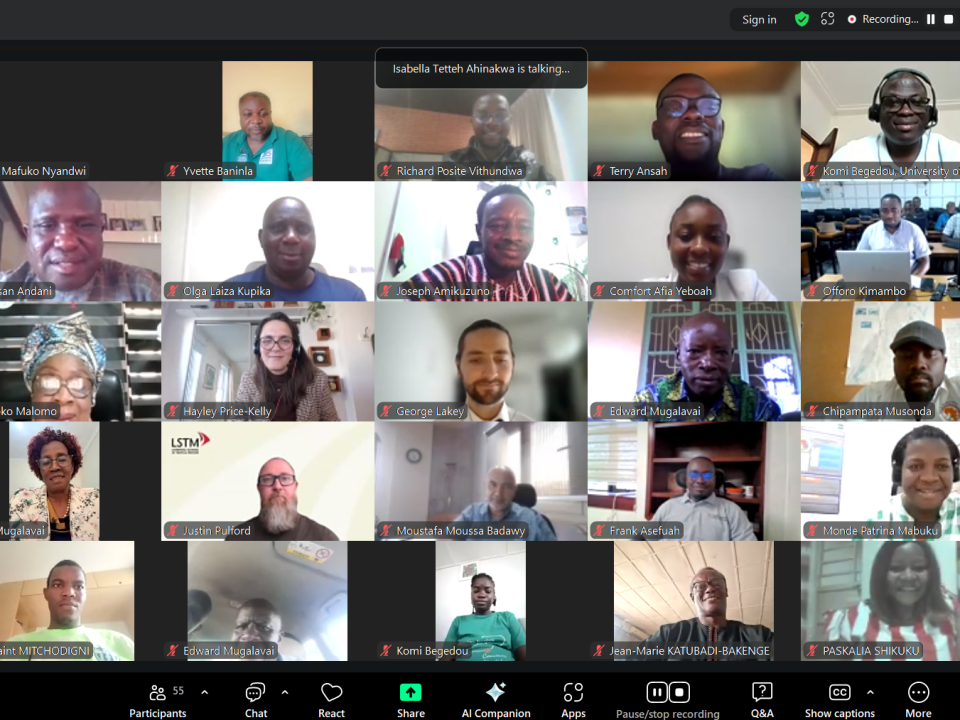Redefining Global Academic Partnerships: China and Africa Build a Shared Future in Higher Education
July 24, 2025
Reimagining Higher Education: African Stakeholders Set Bold Agenda for Innovation, Inclusion, and Sustainable Development
July 25, 2025La collaboration sino-africaine dans l’enseignement supérieur entre dans une nouvelle ère, marquée non pas par un soutien ou un transfert de connaissances unilatéral, mais par la co-création, un leadership mutuel et un alignement stratégique.Tel est le message clair qui s’est dégagé de la session parallèle organisée dans le cadre de la 16ᵉ Conférence générale de l’Association des Universités Africaines (AUA), tenue à Rabat, au Maroc. Cette session portait sur la Réunion annuelle du Mécanisme d’échange du Consortium sino-africain des universités (2025) et sur les échanges et la coopération dans l’enseignement supérieur sino-africain.
Aperçu et Cérémonie d’Ouverture
Le professeur Olusola Oyewole, Secrétaire Général de l’Association des Universités Africaines (AUA), le professeur Yan Chunhua, Vice-président de la Société Chinoise de l’Enseignement Supérieur (CAHE) et membre de l’Académie chinoise des sciences, ainsi que M. Li Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc, ont assisté à la conférence et prononcé des discours de haut niveau. Plus largement, la session a réuni un groupe diversifié de parties prenantes, notamment des responsables de la Banque mondiale, des dirigeants d’universités Africaines et Chinoises, des responsables gouvernementaux, des universitaires, des partenaires industriels et des partenaires de développement. Elle a fourni une plateforme pour réfléchir aux progrès réalisés grâce au mécanisme d’échange, discuter des défis existants et envisager un avenir collaboratif fondé sur l’équité, l’innovation et la durabilité.
M. Li Nan, vice-président et secrétaire général de la CAHE, le professeur Frederick Ato Armah, directeur de la recherche et des programmes de l’AUA, le professeur Zhou Zuoyu, vice-président du conseil universitaire de l’université normale de Pékin et directeur du Centre international de recherche et de formation pour l’éducation rurale de l’UNESCO, ont présidé des sessions et prononcé des discours pendant la conférence. En outre, Ndanduleni Bernard Nthambeleni, vice-chancelier de l’université de Venda, Mme Gao Xiaojie, secrétaire générale adjointe de la CAHE, M. Ransford Bekoe, directeur des partenariats à l’AUA, et le professeur Peng Yi, expert en enseignement supérieur nommé par l’AUA et la CAHE, ont respectivement présidé la conférence.
Lors de la cérémonie d’ouverture, le professeur Olusola Oyewole a déclaré que la coopération universitaire sino-africaine avait donné des résultats positifs depuis son lancement. Le mécanisme d’échange a fourni une plateforme importante aux universités africaines pour développer leur coopération internationale, avec des résultats remarquables dans les domaines des échanges universitaires, du renforcement des capacités, de l’éducation numérique et autres. Les deux parties se sont engagées à respecter les principes d’interaction bidirectionnelle et d’apprentissage mutuel. Le professeur Oyewole a appelé les participants à explorer et à tirer les leçons de l’expérience du projet des centres d’excellence pour l’enseignement supérieur en Afrique de la Banque mondiale, à accroître les investissements dans les domaines de la recherche scientifique en Afrique, à améliorer les conditions de recherche scientifique des universités et à favoriser le développement de la jeunesse africaine. Le vice-président du CAHE, le professeur Yan Chunhua, a déclaré que la coopération éducative est un élément important des relations amicales entre la Chine et l’Afrique, et que le mécanisme d’échange est devenu un moteur important pour l’enseignement supérieur sino-africain.
L’évolution du mécanisme d’échange
Lancé par un protocole d’accord (MoU) en 2022, le mécanisme d’échange entre les universités chinoises et africaines n’a cessé d’étendre sa portée. Dans son rapport de travail, le professeur Yuan Dayong, secrétaire général du secrétariat chinois du consortium et doyen exécutif de l’université des langues étrangères de Pékin, a retracé le parcours du mécanisme au cours des deux dernières années. Des visites initiales et des dialogues numériques aux projets de recherche conjoints, forums universitaires, formations exécutives et plateformes d’échange de connaissances multilingues. Parmi les réalisations notables, citons la formation de talents africains dans divers secteurs tels que l’agriculture et l’éducation, la mise en place d’outils d’apprentissage numériques et l’organisation du plan d’action « China-Africa 100 University Operation Plan » sous l’égide du Campus Afrique de l’UNESCO. Malgré ces avancées, certaines lacunes subsistent. Il a souligné la nécessité d’améliorer les structures de gouvernance, de définir clairement les rôles institutionnels et d’assurer un engagement plus cohérent entre les universités africaines et chinoises. Il a également appelé à la mise en place de modèles de communication flexibles, tels que des réunions hybrides et des micro-consortiums, afin de surmonter les contraintes logistiques liées à la géographie et aux ressources. « Nous devons passer d’une collaboration sporadique à des partenariats durables fondés sur la compréhension mutuelle et la responsabilité partagée », a-t-il déclaré.
La perspective africaine a été présentée par Mme Comfort Yeboah, Chargée des Partenariats à l’AUA, qui a livré un rapport statistique sur les progrès réalisés.
À la mi-2025, 63 universités africaines réparties dans 23 pays avaient été jumelées à des homologues chinoises à travers un processus compétitif, et 13 institutions africaines avaient signé un protocole d’accord (MoU) avec 12 universités chinoises.
Ces chiffres traduisent l’élan croissant derrière ce mécanisme, mais Mme Yeboah a reconnu une série de défis opérationnels : barrières linguistiques, soutien administratif limité, différences culturelles et contraintes financières. Elle a souligné l’engagement de l’AUA à accompagner les universités dans la prochaine phase d’inscriptions, à simplifier les procédures de signature des MoU et à offrir des formations institutionnelles adaptées aux besoins spécifiques des établissements partenaires.
« En défendant cette collaboration, nous ouvrons la porte à des opportunités transformatrices pour nos étudiants, notre corps professoral et nos institutions », a-t-elle affirmé. Son appel aux universités africaines était clair : s’approprier activement la collaboration et en devenir les co-architectes, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre.
Plusieurs présentations au cours de la session ont offert des exemples concrets de cette vision en action. L’Université d’économie et de commerce international (UIBE) de Pékin a présenté son rôle de chef de file dans le Plan de coopération Chine–Afrique 20+20, en mettant en avant ses collaborations avec 18 institutions africaines, la formation de plus de 600 hauts fonctionnaires africains, ainsi que le développement de programmes académiques axés sur le commerce, la transformation numérique et l’entrepreneuriat. Les projets futurs de l’UIBE incluent la création d’un programme de développement des talents dans l’économie numérique, d’un centre de recherche sur le commerce numérique Chine–Afrique, ainsi qu’un concours d’entrepreneuriat numérique visant à rapprocher la théorie académique de la pratique industrielle.
Du côté africain, l’Université de Mulungushi, en Zambie, s’est imposée comme une étude de cas convaincante d’une institution stratégiquement positionnée pour relier la Chine, la Zambie et l’ensemble du continent africain. Le vice-chancelier, le professeur Royson Mukwena, a décrit le rôle de l’université comme celui d’un catalyseur de partenariats triangulaires. Il a mis en avant l’existence de pôles de recherche conjoints dans des domaines tels que la santé, l’agriculture et le changement climatique, et a souligné l’alignement de l’université sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine ainsi que sur les Objectifs de développement durable. Le professeur Mukwena a insisté sur l’importance de créer des laboratoires d’innovation, d’investir dans l’intelligence artificielle, d’élargir les programmes d’échanges de personnel et d’adopter des plateformes numériques bilingues afin de renforcer l’inclusivité et l’accès.
Un appel à des partenariats équilibrés et réciproques
La professeure Folasade Ogunsola, vice-chancelière de l’Université de Lagos, a lancé un appel fort au secteur de l’enseignement supérieur africain.
S’appuyant sur près de deux décennies de collaboration avec des institutions chinoises, y compris la création de l’Institut Confucius au sein de son université, passé d’une initiative d’engagement communautaire à un véritable programme académique délivrant des diplômes en langue chinoise, la professeure Ogunsola a plaidé pour une refonte fondamentale du modèle de partenariat.« Nous devons aller au-delà du modèle unilatéral. L’Afrique n’est pas seulement un bénéficiaire. Nous sommes 54 pays, avec la population la plus jeune du monde et un potentiel inexploité. Ce partenariat doit être à double sens », a-t-elle souligné.
Ses propos ont appelé à un engagement plus poussé de la part des institutions chinoises, notamment la promotion des langues africaines dans les universités chinoises, l’échange réciproque d’enseignants et d’étudiants, ainsi que la création de pôles d’innovation co-gérés. Elle a également plaidé pour la mise en place d’universités virtuelles et de plateformes numériques de savoir destinées à servir les communautés mal desservies, à favoriser un apprentissage inclusif et à permettre une collaboration en temps réel à travers les continents.
La deuxième séance plénière de la session a porté sur la transformation numérique comme pierre angulaire du partenariat éducatif Chine–Afrique. Les intervenants ont souligné que l’intégration de l’intelligence artificielle, des systèmes d’apprentissage en ligne et des réseaux académiques virtuels constitue un impératif stratégique pour la création de systèmes éducatifs durables et inclusifs. Des institutions telles que l’Université KCA au Kenya et l’Université de Xiamen en Chine ont proposé la mise en place d’un cadre bilatéral d’assurance qualité, d’un système de transfert de crédits et l’élaboration d’une charte continentale de coopération académique Chine–Afrique. Ces instruments visent à harmoniser les normes, améliorer la mobilité et favoriser la collaboration transfrontalière dans les domaines de la recherche, de l’entrepreneuriat et de l’élaboration de politiques. Si la session a salué les progrès réalisés, l’appel à l’action a été sans équivoque. Les parties prenantes ont convenu qu’il était temps de dépasser les accords purement cérémoniels pour institutionnaliser ces collaborations au moyen de programmes d’études co-développés, de mécanismes de financement coordonnés, de diplômes conjoints et de modèles de gouvernance partagée. Comme l’a souligné la professeure Peng Yi, experte en enseignement supérieur nommée par la CAHE et l’AAU, également professeure à l’Université technologique de Nankin, le succès du mécanisme d’échange dépendra de sa capacité à produire des résultats concrets, non seulement dans les documents de politique générale, mais aussi dans les salles de classe, les laboratoires et les communautés. Elle a déclaré : « Notre mécanisme n’est aussi solide que sa mise en œuvre. Nous devons tirer parti de la disponibilité financière des universités chinoises et de l’appétit croissant pour l’innovation au sein des institutions africaines. » Elle a également présenté le développement du mécanisme d’échange qui vise à mettre en œuvre l’initiative majeure du “Plan de coopération pour le développement des talents Chine-Afrique” proposé par le président Xi Jinping lors du Dialogue des dirigeants Chine-Afrique en 2023 à Johannesburg. Ce mécanisme d’échange a été intégré dans le Plan d’action de Beijing (2025-2027) du Forum sur la coopération Chine-Afrique. La première réunion annuelle du Consortium des universités Chine-Afrique dans le cadre du mécanisme d’échange (2024) figure parmi les résultats de la mise en œuvre des actions de suivi du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Le docteur Xiaonan Cao, de la Banque mondiale, a présenté une intervention intitulée « Renforcer et élargir les réseaux de collaboration pour un impact accru ».
Le professeur Wahab Olasupo Egbewole, SAN, vice-chancelier de l’Université d’Ilorin, le Dr Samuel Donkor, président et fondateur de l’All Nations University, la vice-présidente, la professeure Ding Xia de l’Université de médecine chinoise de Pékin, M. Abduraghman (Manie) Regal, directeur exécutif des finances et des services à l’Université du Cap occidental, la professeure Zhao Tingting de l’Université de Xiamen, le professeur Huang Xiao de l’Université normale du Zhejiang, ainsi que Mme Wang Siyao de l’Université normale de Pékin, ont également prononcé des discours éclairants.
Le Mécanisme d’échange entre universités Chine-Afrique est bien plus qu’un partenariat symbolique. C’est un cadre ambitieux visant à repenser la manière dont l’enseignement supérieur mondial peut être gouverné, dispensé et transformé – non pas depuis le Nord global, mais grâce à la coopération Sud-Sud.
Cette séance plénière a montré que les universités africaines et chinoises ne se satisfont plus de paradigmes dépassés. Elles en créent un nouveau, qui valorise l’équité plutôt que la hiérarchie, la co-création plutôt que l’imposition, et des avenirs partagés plutôt que des relations purement transactionnelles. Au cœur de cette transformation se trouvent les étudiants, les chercheurs et les communautés, dont les vies seront transformées par la dignité, le savoir et la promesse d’un partenariat à la fois véritablement mondial dans ses ambitions et profondément ancré dans les réalités locales.